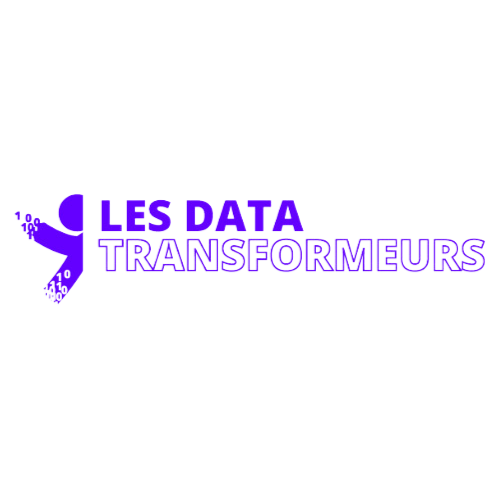EHDS : l’idée d’un “Ségur des données secondaires” lancée lors de la table ronde de la DNS pour la journée sur l’Espace européen
Publié le mercredi 08 octobre 2025 à 10h50
Data Acteur publicUn « Ségur des données secondaires » ? L’idée a émergé lors d'une table ronde organisée par la Direction au numérique en santé sur l’EHDS : bâtir une stratégie collective et souveraine pour rendre la réutilisation des données de santé concrète, en misant sur la gouvernance, l’interopérabilité et la confiance citoyenne.
L’important c’est de « fédérer, standardiser, outiller tout l’écosystème »
Première certitude : avec l’EHDS, les données en soi n’ont plus de valeur marchande. La valeur glisse vers les services autorisés (préparation, standardisation, sécurisation, outillage) autour d’usages bien encadrés et tracés. Les redevances réguleront l’accès ; les modèles économiques s’ancreront ailleurs : qualité, interopérabilité, accompagnement… « Ce n’est pas seulement ouvrir des données : c’est fédérer, standardiser, outiller tout l’écosystème », résume Emmanuel Bacry (HDH), qui voit déjà la continuité entre les missions actuelles de la plateforme et celles du futur ORAD (guichet d’accès, animation, standards de métadonnées, transparence citoyenne).
L‘importance de la qualité et de l’interopérabilité pour les hôpitaux :
Côté terrain, Vincent Vuiblet (CHU de Reims) recadre : la force des entrepôts hospitaliers, c’est la qualité contextualisée, pas la taille. Leur faiblesse ? La multiplicité des EDS. Réponse : fédérer. Le projet F-Data veut rendre visible un point d’entrée unique pour les 32 CHU (et au-delà), connecté à la gouvernance nationale mais sans perdre l’agilité locale. Objectif : un espace de données hospitalier lisible, interopérable, compétitif au niveau européen.
Pour Barbara Benssoussan Sellam (Lifen), un angle mort demeure : la définition opérationnelle des entités d’intermédiation des données (EID). Préparer la donnée (pseudonymiser, anonymiser) relève des redevances ; mais la structuration/curation avancée va plus loin et doit rester contractualisable de gré à gré pour ne pas assécher l’innovation. Message implicite : besoin de guides très concrets pour que chaque acteur sache où il se situe, et comment financer durablement ses activités.
L’accès réel aux données dépend de “tuyaux”
Dans les labos, Julien Bezin pointe “deux cailloux dans la chaussure” : les délais d’accès qui sont encore longs et une interopérabilité incomplète. Les modèles de données communs existent, mais terminologies, outils et compétences locales restent décisifs pour des analyses décentralisées à l’échelle européenne. Il insiste sur le fait que sans “tuyaux” fiables ni experts sur site, il n’y a pas d’accès utilisable.
Marie Zins rappelle la continuité RGPD : finalités autorisées (intérêt public, recherche), finalités interdites (publicité, décisions préjudiciables), minimisation, durées d’autorisation limitées (jusqu’à 10 ans) et effacement. Côté citoyens : droit à l’information, transparence des projets autorisés et droit de refus (proche de l’opposition RGPD), exerçable à tout moment. Surtout, la CNIL insiste sur un rôle d’accompagnement (concertations, bacs à sable, hotline, méthodologies de référence) plutôt que sur une logique punitive. « La régulation doit être intelligente et dialoguée. L’objectif est de protéger sans freiner la recherche », plaide la commissaire.
L’idée d’un “Ségur des données secondaires” émerge
Dominique Pon (Docaposte) va droit au but : le terrain est globalement favorable à l’EHDS, mais il faut passer de l’animation à l’alliance entre publics, régulateurs, producteurs et industriels. Trois priorités :
-
une doctrine data-centric à la source (SI hospitaliers et médico-sociaux) pour réduire la fragmentation ;
-
construire les “tuyaux” d’interopérabilité entre entrepôts et plateformes nationales, avec les industriels ;
-
un “Ségur” des données secondaires, calqué sur l’esprit des socles nationaux, pour industrialiser l’accès (la “cohorte en clic-bouton” reste un horizon, mais il faut financer les fondations).
En filigrane : une doctrine de souveraineté (technique, sanitaire et économique) pour recycler la valeur au bénéfice des citoyens qui financent le système.
Tous les intervenants de cette table ronde s’accordent : pas de succès sans onboarding citoyen. La plateforme des données de santé (PDS – HDH) multiplie registres publics, portails droits, webinaires et requêtes “à la demande” pour les associations. Reste à élever la pédagogie : expliquer les risques du partage mais aussi les coûts du non-partage (recherche plus lente, soins moins personnalisés), afin que chacun décide en connaissance de cause.